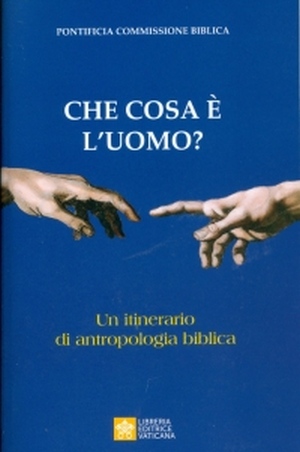 À cause d’une « légère indisposition », c’est chez lui, via le web, que Jorge Mario Bergoglio a dû suivre les exercices spirituels de début de Carême qui se sont déroulés dans le village d’Ariccia dans le parc des Castelli Romani et qui se sont terminés aujourd’hui, vendredi 6 mars.
À cause d’une « légère indisposition », c’est chez lui, via le web, que Jorge Mario Bergoglio a dû suivre les exercices spirituels de début de Carême qui se sont déroulés dans le village d’Ariccia dans le parc des Castelli Romani et qui se sont terminés aujourd’hui, vendredi 6 mars.
Mais le Pape n’aura certainement pas perdu une miette des paroles du prédicateur qu’il a ardemment souhaité cette année : le jésuite Pietro Bovati, 80 ans, professeur d’Écriture Sainte à l’Institut biblique pontifical de l’Université grégorienne, consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi et membre depuis douze ans de la Commission biblique pontificale dont il est également le secrétaire.
Le P. Bovati est un bibliste de grande renommée et le Pape François le tient en haute estime, même s’il ne fait pas partie du cercle de ses courtisans. Et on lui doit ce qui est probablement le plus beau document produit par le Saint-Siège au cours des sept années du pontificat actuel.
Le P. Bovati a intitulé ses exercices spirituels par ces mots de l’Exode : « Le buisson brûlait ». Et il a mis en exergue de sa réflexion « la rencontre entre Dieu et l’homme », de Moïse à Jésus au croyant.
Un thème qui fait à nouveau écho au titre du livre qu’il édité : « Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica » [Qu’est-ce que l’homme ? Un itinéraire d’anthropologie biblique].
Ce document a été rédigé par un collectif d’auteurs appartenant à la Commission biblique pontificale, présidée par le Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et composée d’experts unanimement reconnus. En ont fait partie par le passé – pour se limiter aux seuls jésuites – des biblistes d’envergure tels que Carlo Maria Martini, Albert Vanhoye, Stanislas Lyonnet, Ignace de la Potterie, Klemens Stock et Ugo Vanni. Et aujourd’hui c’est le P. Bovati qui en est le numéro un effectif.
Ce document sort même du commun par ses dimensions. Il s’agit d’un volume de 336 pages et, tout captivant qu’il soit, il n’a malheureusement été imprimé par la Librairie Éditrice du Vatican qu’en quelques exemplaires en langue italienne qui ont tous été rapidement écoulés. Pour définir ce qu’est l’homme selon les Saintes Écritures, cet document prend comme point de départ le merveilleux récit de la création de Genèse 2–3 pour en reparcourir les scènes et les thèmes qui y sont développés d’abord dans les livres de la Torah et ensuite à travers les prophètes et les écrits sapientiaux, avec une attention particulière aux psaumes, avant d’aboutir enfin à leur accomplissement dans les Évangiles et dans les écrits des apôtres.
Il en ressort un itinéraire fascinant d’anthropologie biblique, dans le grand respect des genres littéraires de l’Ecriture et de l’expressivité symbolique et narrative des textes.
Mais qui a voulu que l’on rédige ce document, et pourquoi ?
À la une du dernier numéro de « La Civiltà Cattolica », le P. Bovati répond lui-même à cette question. Cet ouvrage, écrit-il, a été conçu pour être un « manuel de référence » dans les facultés de théologie, en matière d’anthropologie biblique, et il « a été souhaité par le Pape François ».
Et en effet, si l’on parcourt l’agenda de l’Institut biblique pontifical sur son site officiel, on découvre que sous le pontificat actuel, entre 2015 et 2018, les sessions plénières annuelles de l’Institut ont toutes eue pour thème précisément l’anthropologie biblique, les trois premières se sont déroulées sous la présidence du cardinal Gerhard Müller, quand il était Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et la dernière sous la présidence de son successeur, le cardinal Luis F. Ladaria, et que c’est le P. Bovati qui a était à chaque fois secrétaire.
Le peu d’attention qui a accueilli la sortie de cet ouvrage est donc immérité. Il y a bien eu quelques protestations chez ceux qui ont vu dans la manière dont le livre traite le thème de l’homosexualité une concession à la théorie du « gender », en particulier dans la réinterprétation du récit de Sodome en Genèse 19.
C’est vrai. Comme le P. Bovati l’a même répété dans « La Civiltà Cattolica », l’interprétation qu’en fait le livre est que « dans le récit biblique, la ville de Sodome n’est pas condamnée à cause de sa désavouable concupiscence sexuelle, mais plutôt à cause de son manque d’hospitalité envers l’hôte étranger, avec une hostilité et des violences dignes du châtiment suprême ».
Mais les dix pages que le livre consacre à ce sujet font également la place belle aux très sévères normes du Lévitique contre les comportements homosexuels ainsi que pour la diatribe enflammée de Paul dans le chapitre 1 de la lettre aux Romains, sans édulcoration aucune ni « réinterprétation » conciliante, mis à part, dans une note finale, la nécessaire « attention pastorale pour les personnes individuelles ».
Nous reproduisons ci-dessous, en guise de mise en bouche pour inciter à a lecture du livre, un extrait de l’article du P. Bovati publié dans « La Civiltà Cattolica ».
Mais pour apprécier la valeur et la liberté d’esprit de ce grand biblique, il est également utile de mentionner le travail exégèse perspicace qu’il mène depuis deux ans, toujours dans les colonnes de « La Civiltà Cattolcia » autour du débat sur la demande du « Pater noster » qui en latin se dit : « Et ne nos inducas in tentationem ».
En italien et en anglais, les traductions utilisées à la messe sont calquées sur la formulation latine et sont respectivement « E non c’indurre in tentatzione » et « And lead us not into temptation ».
Mais « cette traduction n’est pas bonne », avait déclaré le pape François le 6 décembre 2017 en commentant le « Pater noster » sur TV 2000, la chaîne de la Conférence épiscopale italienne. Laquelle s’est rapidement rangée à ses arguments en décrétant finalement qu’à partir du premier dimanche de l’Avent 2020, on dira à la messe : « E non abbandonarci nella tentazione ».
Sur ce plan, on ne peut qu’être marqué par le fait que le P. Bovati ne se soit nullement rangé aux désirs de François mais qu’il ait en revanche cherché à fond et expliqué – sans adaptations illusoires – le véritable sens original de ces paroles dans la prière enseignée par Jésus.
Mais revenons à son livre « Che cosa è l’uomo ? ». Voici un passage de l’introduction que le P. Bovati a rédigée dans les pages de « La Civiltà Cattolica » le 1er février 2020.
Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.
*
Petit guide de lecture du récit de la création
de Pietro Bovati S.J.
Mentionnons à présent quelques contributions innovantes du document de la Commission biblique pontificale. Par exemple, on y trouve une interprétation traditionnelle de Genèse 2, 21–23 qui affirme que la femme a été créée après l’homme (mâle), à partir de l’une de ses « côtes ». Dans le document, on examine attentivement la terminologie employée par le narrateur biblique (par exemple en critiquant la traduction du terme hébreux « tsela » par « côte ») et on suggère une autre lecture de l’événement :
« Jusqu’au verset 20, le narrateur parle d’ ‘adam’ sans aucune autre précision sexuelle ; la généricité de la présentation nous impose de renoncer à imaginer la configuration précise d’un tel être, et encore moins à recourir à la forme monstrueuse de l’androgyne. Nous sommes en effet invités à nous soumettre avec ‘adam’ à une expérience de non-connaissance, de manière à découvrir, à travers la révélation, le merveilleux prodige opéré par Dieu (cf. Genèse 15, 12 ; Job 33, 15). Personne en effet ne connaît le mystère de sa propre origine. Cette phase de non-vision est symboliquement représentée par l’acte du Créateur qui ‘fait tomber un sommeil mystérieux sur ‘adam’ qui s’endormit’ (v 21) : le sommeil n’a pas la fonction d’anesthésie totale afin de permettre une opération indolore mais il évoque plutôt la manifestation d’un événement inimaginable, celui par lequel à partir d’un seul être (‘adam’), Dieu en forme eux, homme (‘ish’) et femme (‘isha’). Et cela non seulement pour indiquer leur ressemblance radicale mais pour laisser entrevoir que leur différence nous invite à découvrir le bien spirituel de leur reconnaissance (réciproque), principe de communion d’amour et appel à devenir ‘une seule chair’ (v. 24). Ce n’est donc pas la solitude du mâle qui est secourue mais bien celle de l’être humain, à travers la création de l’homme et de la femme » (n°153).
Un autre exemple. L’aspect problématique inhérent à l’ « interdit » [de manger d’un arbre du jardin] est soigneusement analysé dans le commentaire exégétique de Genèse 2, 16–17, afin de pas corroborer l’idée que Dieu s’opposerait, de manière arbitraire, au désir humain. En réalité, le Créateur manifeste sa libéralité en mettant à disposition de la créature « tous les arbres du jardin » (Genèse 1, 11–12 ; 2, 8–9). Et pourtant :
« Il y a une limite à la totalité de son don : Dieu demande à l’homme de s’abstenir de manger le fruit d’un seul arbre, situé à côté de l’arbre de la vie (Genèse 2, 9) mais bien distinct de ce dernier. L’interdiction est toujours une limite posée à la volonté de tout posséder, à cette envie (autrefois appelée ‘concupiscence’) que l’homme ressent comme une pulsion innée de plénitude. Céder à cette envie revient à faire disparaître idéalement la réalité du donateur ; elle élimine donc Dieu, mais, dans le même temps, elle détermine également la fin de l’homme, qui vit parce qu’il est don de Dieu. Ce n’est qu’en respectant le commandement, qui constitue une sorte de barrière au débordement égoïste de la volonté propre, que l’homme reconnaît le Créateur, dont la réalité est invisible mais dont l’arbre interdit en particulier est signe de la présence. Interdit non pas par jalousie mais par amour, pour sauver l’homme de la folie de la toute-puissance » (n°274).
Un autre exemple encore. On interprète souvent le fait que le serpent se soit adressé à la femme plutôt qu’à l’homme (comme le rapporte en Genèse 3) comme une astuce du tentateur qui aurait choisi de s’attaquer à la personne la plus vulnérable, la plus facile à berner. On peut toutefois rappeler que la figure féminine est dans la Bible l’image privilégiée de la sagesse (humaine) :
« Si on adopte cette perspective, la confrontation de Genèse 3 ne se déroule pas entre un être très intelligent et une sotte mais au contraire entre deux manifestations de la sagesse, et la ‘tentation’ porte principalement sur cette haute qualité de l’être humain qui, dans son désir de ‘connaître’, risque de pêcher par orgueil en prétendant être Dieu au lieu de se reconnaître comme un fils qui reçoit tout de son Créateur et Père » (n°298).
Un dernier exemple. On entend souvent dire que Dieu intervient pour sanctionner le péché des ancêtres par des châtiments (Genèse 3, 16–19) ; il faut en revanche considérer la punition comme un acte de justice nécessaire, et c’est d’ailleurs ce qui ressort d’une lecture attentive du texte biblique. Il faut cependant rappeler que la première décision du Créateur c’est la malédiction du serpent, associée à la promesse de la victoire de la descendance de la femme sur les menaces insidieuses du tentateur (Genèse 3, 14–15). De plus, les souffrances qui frappent les potentialités de la femme et de l’homme doivent être considérées comme des dispositions sapientales, voulues par Dieu parce qu’utiles à l’être humain, en ce qu’elles favorisent dans la créature cette humble disposition du cœur qui est chemin de vie. […]
Plus généralement, sur la manière dont l’Écriture présente l’intervention de Dieu dans l’histoire quand le péché apparaît, la modalité du « jugement », qui débouche sur la condamnation, ne constitue pas la forme la plus représentative du rétablissement de la justice divine. L’Écriture montre plutôt au contraire que le Seigneur, en tant que partenaire de l’alliance, prend l’apparence de l’accusateur (dans le mécanisme du « rîb » [(« controverse », « dispute », « procès »]) pour favoriser la conversion du pêcheur et que c’est sur celle-ci qu’il greffe son acte de pardon :
« L’événement final du ‘rîb’ se réalise donc comme une rencontre renouvelée entre la volonté bienveillante du Père et le libre consentement du fils, une rencontre de vérité qui fait ressortir l’amour du Seigneur et sa puissance salvifique. Tout le message prophétique de l’Ancien Testament est promesse de cet événement, et tout le Nouveau Testament est l’attestation de l’accomplissement béatifiant de ce qui avait été annoncé comme sens de l’histoire, avec une manifestation qui ne se limite plus seulement à Israël mais qui s’étend à toutes les nations, rassemblées sous le même sceau de la miséricorde, dans une nouvelle et éternelle alliance » (n°333)
