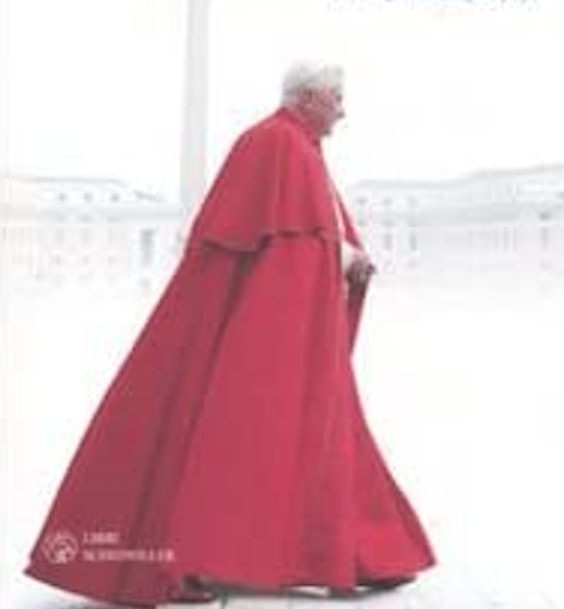 (S.M.) En ces jours de “Noël” de Joseph Ratzinger à la vie éternelle, nous vous proposons ci-dessous une anthologie de quelques-uns de ses discours essentiels, ceux qui condensent sa vision de la mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui, en dialogue constant entre foi et raison.
(S.M.) En ces jours de “Noël” de Joseph Ratzinger à la vie éternelle, nous vous proposons ci-dessous une anthologie de quelques-uns de ses discours essentiels, ceux qui condensent sa vision de la mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui, en dialogue constant entre foi et raison.
On trouvera un lien vers le texte intégral de chaque discours dont nous reproduisons les passages les plus marquants.
Le premier discours est celui avant Noël du 22 décembre 2005 à la Curie romaine, dans lequel le Pape Benoît XVI a éclairci sa clé d’interprétation du Concile Vatican II : non pas en tant que rupture avec le passé et nouveau départ mais plutôt en tant qu’“herméneutique de la réforme, du renouvellement dans la continuité de l’unique sujet-Église”. Principalement dans le but de prendre la défense du décret conciliaire sur la liberté religieuse, le plus contesté par les traditionnalistes.
Le second est celui qu’il a prononcé le 12 décembre 2006 à l’Université de Ratisbonne et dans lequel il présente comme essentielle à la foi chrétienne la rencontre entre le message biblique et la pensée grecque, une rencontre plusieurs fois contestée au cours de l’histoire, et qui est pourtant selon lui essentielle, encore aujourd’hui, pour la mission de l’Église.
Le troisième discours, celui du 22 décembre 2006 à la Curie romaine, est repris ici comme corollaire du précédent, pour la réponse implicite fournie par Benoît XVI aux violentes réactions qui ont enflammé le monde musulman à la suite d’un passage de son discours de Ratisbonne. L’espoir du Pape, c’est que l’islam aussi passe à travers le crible de la raison des Lumières, comme cela s’est déjà produit – fastidieusement mais avec succès — pour le christianisme.
Le quatrième est celui du 12 septembre 2006 au Collège des bernardins de Paris. C’est celui dans lequel Benoît XVI le Pape Benoît XVI montre que le fondement de la civilisation de l’Europe et de l’Occident réside dans le “quaerere Deum”, la recherche de Dieu des moines du Moyen Âge, avec tout ce que cette dernière a produit dans le domaine de l’exégèse biblique, de la théologie, de la liturgie, des arts, de la littérature, de la société.
Le cinquième est celui du 22 septembre 2011 au Reichstag, le parlement de Berlin. Dans celui-ci, Benoît XVI met en garde contre les risques de la dictature dominante du positivisme juridique, qui mine précisément cette rencontre décisive entre Jérusalem, Athènes et Rome, entre la foi en Dieu d’Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique romaine, qui a édifié la civilisation occidentale.
On constate entre tous ces discours une extraordinaire cohérence. Mais on voit également à quel point ils sont incontournables et exigeants pour l’Église qui les reçoit en héritage.
*
> À la Curie romaine, le 22 décembre 2005
Le Concile Vatican II, reconnaissant et faisant sien à travers le Décret sur la liberté religieuse un principe essentiel de l’Etat moderne, a repris à nouveau le patrimoine plus profond de l’Eglise. Celle-ci peut être consciente de se trouver ainsi en pleine syntonie avec l’enseignement de Jésus lui-même (cf. Mt 22, 21), comme également avec l’Eglise des martyrs, avec les martyrs de tous les temps.
L’Eglise antique, de façon naturelle, a prié pour les empereurs et pour les responsables politiques, en considérant cela comme son devoir (cf. 1 Tm 2, 2); mais, tandis qu’elle priait pour les empereurs, elle a en revanche refusé de les adorer, et, à travers cela, a rejeté clairement la religion d’Etat. Les martyrs de l’Eglise primitive sont morts pour leur foi dans le Dieu qui s’était révélé en Jésus Christ, et précisément ainsi, sont morts également pour la liberté de conscience et pour la liberté de professer sa foi, — une profession qui ne peut être imposée par aucun Etat, mais qui ne peut en revanche être adoptée que par la grâce de Dieu, dans la liberté de la conscience. […]
Le Concile Vatican II, avec la nouvelle définition de la relation entre la foi de l’Eglise et certains éléments essentiels de la pensée moderne, a revisité ou également corrigé certaines décisions historiques, mais dans cette apparente discontinuité, il a en revanche maintenu et approfondi sa nature intime et sa véritable identité. […]
Mais à notre époque, l’Eglise demeure un “signe de contradiction” (Lc 2, 34). […] Le Concile ne pouvait avoir l’intention d’abolir cette contradiction de l’Evangile à l’égard des dangers et des erreurs de l’homme. En revanche, son intention était certainement d’écarter les contradictions erronées ou superflues, pour présenter à notre monde l’exigence de l’Evangile dans toute sa grandeur et sa pureté. Le pas accompli par le Concile vers l’époque moderne, qui de façon assez imprécise a été présenté comme une “ouverture au monde”, appartient en définitive au problème éternel du rapport entre foi et raison.
*
> À l’Université de Ratisbonne, le 12 septembre 2006
Est-ce seulement grec de penser qu’agir de façon contraire à la raison est en contradiction avec la nature de Dieu, ou cela vaut-il toujours et en soi ? Je pense que, sur ce point, la concordance parfaite, entre ce qui est grec, dans le meilleur sens du terme, et la foi en Dieu, fondée sur la Bible, devient manifeste. En référence au premier verset de la Genèse, premier verset de toute la Bible, Jean a ouvert le prologue de son évangile par ces mots : « Au commencement était le ‘logos’ ». […] La rencontre du message biblique et de la pensée grecque n’était pas le fait du hasard. […] Fondamentalement, il s’agit d’une rencontre entre la foi et la raison, entre l’authentique philosophie des Lumières et la religion. […]
La revendication de déshellénisation du christianisme, qui, depuis le début de l’époque moderne, domine de façon croissante le débat théologique, s’oppose à la thèse selon laquelle l’héritage grec, purifié de façon critique, appartient à la foi chrétienne. […]
Au regard de la rencontre avec la pluralité des cultures, on dit volontiers aujourd’hui que la synthèse avec l’hellénisme, qui s’est opérée dans l’Église antique, était une première inculturation du christianisme qu’il ne faudrait pas imposer aux autres cultures. Il faut leur reconnaître le droit de remonter en deçà de cette inculturation vers le simple message du Nouveau Testament, pour l’inculturer à nouveau dans leurs espaces respectifs. Cette thèse n’est pas simplement erronée mais encore grossière et inexacte. Car le Nouveau Testament est écrit en grec et porte en lui-même le contact avec l’esprit grec, qui avait mûri précédemment dans l’évolution de l’Ancien Testament. Certes, il existe des strates dans le processus d’évolution de l’Église antique qu’il n’est pas besoin de faire entrer dans toutes les cultures. Mais les décisions fondamentales, qui concernent précisément le lien de la foi avec la recherche de la raison humaine, font partie de la foi elle-même et constituent des développements qui sont conformes à sa nature. […]
C’est ainsi seulement que nous devenons capables d’un véritable dialogue des cultures et des religions, dont nous avons un besoin si urgent. […] Pour la philosophie et, d’une autre façon, pour la théologie, écouter les grandes expériences et les grandes intuitions des traditions religieuses de l’humanité, mais spécialement de la foi chrétienne, est une source de connaissance à laquelle se refuser serait une réduction de notre faculté d’entendre et de trouver des réponses. […] Depuis longtemps, l’Occident est menacé par cette aversion pour les interrogations fondamentales de la raison et il ne pourrait qu’en subir un grand dommage. Le courage de s’ouvrir à l’ampleur de la raison et non de nier sa grandeur – tel est le programme qu’une théologie se sachant engagée envers la foi biblique doit assumer dans le débat présent. Ne pas agir selon la raison, ne pas agir avec le Logos, est en contradiction avec la nature de Dieu.
*
> À propos de l’islam, le 22 décembre 2006
Le monde musulman se trouve aujourd’hui avec une grande urgence face à une tâche très semblable à celle qui fut imposée aux chrétiens à partir du siècle des Lumières et à laquelle le Concile Vatican II a apporté des solutions concrètes pour l’Eglise catholique au terme d’une longue et difficile recherche. […]
D’une part, nous devons nous opposer à la dictature de la raison positiviste, qui exclut Dieu de la vie de la communauté et de l’organisation publique, privant ainsi l’homme de ses critères spécifiques de mesure. D’autre part, il est nécessaire d’accueillir les véritables conquêtes de la philosophie des Lumières, les droits de l’homme et en particulier la liberté de la foi et de son exercice, en y reconnaissant les éléments essentiels également pour l’authenticité de la religion.
*
Au Collège des Bernardins de Paris, le 12 septembre 2008
Sous de nombreux aspects, la situation actuelle est différente de celle que Paul a rencontrée à Athènes, mais, tout en étant différente, elle est aussi, en de nombreux points, très analogue. Nos villes ne sont plus remplies d’autels et d’images représentant de multiples divinités. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand Inconnu.
Malgré tout, comme jadis où derrière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu inconnu, de même, aujourd’hui, l’actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui Le concerne. “Quaerere Deum” – chercher Dieu et se laisser trouver par Lui : cela n’est pas moins nécessaire aujourd’hui que par le passé. Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l’humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable.
*
> Au Reichstag de Berlin, le 22 septembre 2011
Comment reconnaît-on ce qui est juste? Dans l’histoire, les règlements juridiques ont presque toujours été motivés de façon religieuse: sur la base d’une référence à la divinité on décide ce qui parmi les hommes est juste. Contrairement aux autres grandes religions, le christianisme n’a jamais imposé à l’État et à la société un droit révélé, ni un règlement juridique découlant d’une révélation. Il a au contraire renvoyé à la nature et à la raison comme vraies sources du droit – il a renvoyé à l’harmonie entre raison objective et subjective, une harmonie qui toutefois suppose le fait d’être toutes deux les sphères fondées dans la Raison créatrice de Dieu.
Avec cela les théologiens chrétiens se sont associés à un mouvement philosophique et juridique qui s’était formé depuis le IIème siècle av. JC. Dans la première moitié du deuxième siècle préchrétien, il y eut une rencontre entre le droit naturel social développé par les philosophes stoïciens et des maîtres influents du droit romain. Dans ce contact est née la culture juridique occidentale, qui a été et est encore d’une importance déterminante pour la culture juridique de l’humanité. De ce lien préchrétien entre droit et philosophie part le chemin qui conduit, à travers le Moyen-âge chrétien, au développement juridique des Lumières jusqu’à la Déclaration des Droits de l’homme. […]
Mais un dramatique changement de la situation est arrivé au cours du dernier demi siècle. L’idée du droit naturel est considérée aujourd’hui comme une doctrine catholique plutôt singulière, sur laquelle il ne vaudrait pas la peine de discuter en dehors du milieu catholique, de sorte qu’on a presque honte d’en mentionner même seulement le terme. […] Ce qui n’est pas vérifiable ou falsifiable ne rentre pas dans le domaine de la raison au sens strict. C’est pourquoi l’ethos et la religion doivent être assignés au domaine du subjectif et tombent hors du domaine de la raison au sens strict du mot. Là où la domination exclusive de la raison positiviste est en vigueur – et cela est en grande partie le cas dans notre conscience publique – les sources classiques de connaissance de l’ethos et du droit sont mises hors jeu. […] La raison positiviste, qui se présente de façon exclusiviste et n’est pas en mesure de percevoir quelque chose au-delà de ce qui est fonctionnel, ressemble à des édifices de béton armé sans fenêtres, où nous nous donnons le climat et la lumière tout seuls et nous ne voulons plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu.
Toutefois nous ne pouvons pas nous imaginer que dans ce monde auto-construit nous puisons en secret également aux «ressources» de Dieu, que nous transformons en ce que nous produisons. Il faut ouvrir à nouveau tout grand les fenêtres, nous devons voir de nouveau l’étendue du monde, le ciel et la terre et apprendre à utiliser tout cela de façon juste.
Mais comment cela se réalise-t-il? Comment trouvons-nous l’entrée dans l’étendue, dans l’ensemble? Comment la raison peut-elle retrouver sa grandeur sans glisser dans l’irrationnel? Comment la nature peut-elle apparaître de nouveau dans sa vraie profondeur, dans ses exigences et avec ses indications? Je rappelle un processus de la récente histoire politique. […] L’importance de l’écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui aujourd’hui comme hier est –me semble-t-il- largement négligé: il existe aussi une écologie de l’homme. L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté. L’homme n’est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L’homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature, et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l’écoute et quand il s’accepte lui-même pour ce qu’il est, et qu’il accepte qu’il ne s’est pas créé de soi. C’est justement ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine. […] Est-ce vraiment privé de sens de réfléchir pour savoir si la raison objective qui se manifeste dans la nature ne suppose pas une Raison créatrice, un “Creator Spiritus”?
À ce point le patrimoine culturel de l’Europe devrait nous venir en aide. Sur la base de la conviction de l’existence d’un Dieu créateur se sont développées l’idée des droits de l’homme, l’idée d’égalité de tous les hommes devant la loi, la connaissance de l’inviolabilité de la dignité humaine en chaque personne et la conscience de la responsabilité des hommes pour leur agir. Ces connaissances de la raison constituent notre mémoire culturelle. L’ignorer ou la considérer comme simple passé serait une amputation de notre culture dans son ensemble et la priverait de son intégralité. La culture de l’Europe est née de la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome – de la rencontre entre la foi au Dieu d’Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome. Cette triple rencontre forme l’identité profonde de l’Europe. Dans la conscience de la responsabilité de l’homme devant Dieu et dans la reconnaissance de la dignité inviolable de l’homme, de tout homme, cette rencontre a fixé des critères du droit, et les défendre est notre tâche en ce moment historique.
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.
