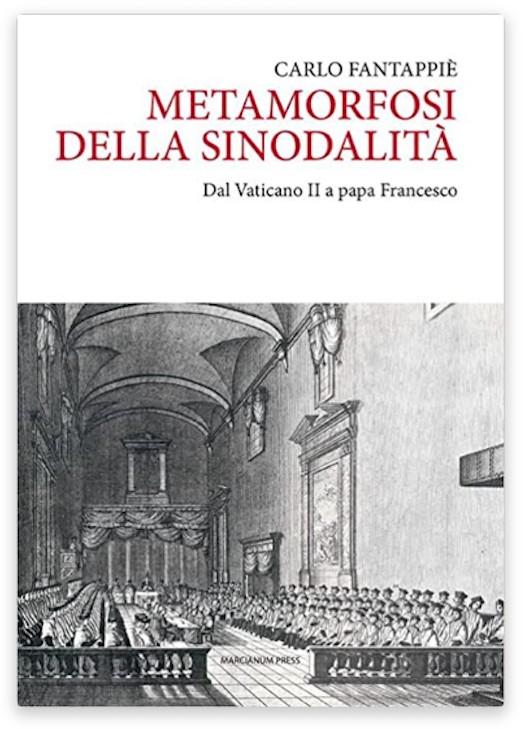 Alors que s’achèvent les synodes continentaux qui vont ensuite confluer vers le synode mondial sur la synodalité programmé à Rome en octobre de cette année et l’année prochaine, l’essai d’un éminent canoniste qui révèle au grand jour, et avec une rare compétence, les limites comme les risques de ce projet majeur du pontificat de François est sur le point de sortir en librairie le 24 février prochain en Italie.
Alors que s’achèvent les synodes continentaux qui vont ensuite confluer vers le synode mondial sur la synodalité programmé à Rome en octobre de cette année et l’année prochaine, l’essai d’un éminent canoniste qui révèle au grand jour, et avec une rare compétence, les limites comme les risques de ce projet majeur du pontificat de François est sur le point de sortir en librairie le 24 février prochain en Italie.
Cet essai, édité chez Marcianum Press, s’intitule : « Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco ». Son auteur est Carlo Fantappiè, professeur de droit canon à l’Université de Rome Trois et à l’Université Grégorienne, membre de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et auteur d’ouvrages importants notamment sur l’histoire de l’Église, du point de vue du droit.
En un peu plus d’une centaine de pages, faciles à lire mais très bien documentées, le professeur Fantappiè reparcourt dans un premier temps la naissance et le développement de l’idée de synodalité, à partir du Concile Vatican II et des turbulents synodes nationaux des années 1970 aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d’autres pays. Il en décrit l’élaboration qui s’en suivit grâce à des théologiens et des canonistes issus de différents pays et de différentes écoles, y compris la Commission théologique internationale avec son document « ad hoc » de 2018. Et enfin, il en étudie la mise en œuvre au sein du « processus » que François a entamé.
Selon Fantappiè, il ne fait aucun doute que François a en tête « un nouveau modèle d’Église ». « Après le modèle grégorien, le modèle tridentin, le modèle juridico-fonctionnel, celui du peuple de Dieu, voilà qu’est en train d’émerger le modèle d’Église synodale ». Il est cependant difficile de comprendre précisément de quoi il s’agit, étant donné qu’il est soumis à des variations continues de la part du Pape lui-même « quasiment de mois en mois ».
« Il me semble comprendre – écrit Fantappiè – que le Pape François ait l’intention de constituer un axe préférentiel, permanent, entre synodalité et synode des évêques », jusqu’au point, peut-être, de « mettre en œuvre la transition d’une ‘Église hiérarchique’ vers une ‘Église synodale’ en état permanent, et donc d’en modifier la structure de gouvernement en tourant le dos à un millénaire basé sur le Pape, la Curie romaine et le collège des cardinaux ».
C’est au seuil de cette mutation annoncée de la structure même de l’Église, mise en branle par François, que Fantappiè conclut son essai. Mais il est utile de passer en revue les « cinq risques majeurs » qu’il identifie dans cette nouvelle synodalité, telle qu’elle se profile aujourd’hui.
Le premier risque, selon lui, c’est que la synodalité finisse par devenir « un critère réglementaire suprême du gouvernement permanent de l’Église », supérieur aussi bien à la collégialité épiscopale qu’à l’autorité primatiale du Pape.
Cela reviendrait ni plus ni moins à revenir à la « voie conciliariste » de Constance et Bâle de la première moitié du quinzième siècle, qui a été un véritable « bouleversement de l’équilibre constitutionnel de l’Église ». Nous aurions avec elle une « Église d’assemblée » et donc « ingouvernable et faible, exposée à des conditionnements de la part du pouvoir politique, économique et médiatique », au sujet desquels « l’histoire des Églises réformées et des Église congrégationnistes a quelque chose à nous apprendre ».
Une second danger, écrit Fantappiè, réside dans « une vision idéaliste et romantique de la synodalité », qui ne prenne pas au sérieux « la réalité des dissensions et du conflit dans la vie de l’Église » et qui se refuserait donc à prévoir des normes et des pratiques adaptées à les gérer. Alors qu’il serait au contraire « nécessaire non seulement de définir les principes et les règles concernant la modalité de représentation électorale des différentes classes de fidèles et les procédures prévues pour gérer les débats et les votes, tout en garantissant de tous les participants les informations nécessaires pour appréhender les problèmes et pour pouvoir prendre des décisions réalistes ».
Un troisième risque consiste en « une vision plastique, générique et indéterminée de la synodalité ». Précisément parce que sans une configuration conceptuelle précise, « le terme ‘synodalité’ risque désormais de devenir, selon les cas, un slogan (un terme impropre et dont on abuse pour désigner le renouvellement de l’Église), un ‘refrain’ (une ritournelle qui revient à chaque occasion, presque par effet de mode) ou un mantra (une invocation miraculeuse en mesure de guérir tous les maux de l’Église). »
Ce qui fait défaut, écrit Fantappiè, c’est « un critère pour pouvoir distinguer et différencier ce qui est ‘synodal’ et ce qui ne l’est pas ». Avec pour résultat que « la nouvelle synodalité risque de se réduire à des rencontres, des assemblées et des colloques à différents niveaux de l’organisation ecclésiale », très similaires, quant à leur organisation et leurs modalités, « aux synodes nationaux qui se sont déroulés au début des années 1970 dans différents pays d’Europe, et qui ont globalement débouché sur un échec ». Ces synodes étaient « une sorte de transposition dans la vie de l’Église du mouvement d’assemblée qui s’est affirmé, après 1968, dans certains milieux des sociétés démocratiques occidentales et qui était fondé sur le principe que la ‘base’ devrait participer directement aux processus de décision ».
Il n’en demeure pas moins, observe Fantappiè, que les cénacles actuels n’ont rien à voir avec les « conciles particuliers » célébrés de manière ininterrompue dans l’Église à partir du IIe siècle et qui ont eu pour objectif, à partir du IVè Concile du Latran de 1215 et suivants, « l’application et l’adaptation des normes communes des conciles généraux à la réalité des Église particulières ». Ces conciles particuliers sont toujours prescrits par le droit canon, même si aucune récurrence précise n’est imposée, mais leur abandon constitue « une grande perte pour la vie de l’Église », que le fatras de meetings et de forums aujourd’hui à la mode ne parvient pas à combler.
Ce qui nous amène au quatrième risque, identifié par Fantappiè « dans la prévalence du modèle sociologique plutôt que théologico-canonique du processus synodal ». Le document de la Commission théologique internationale sur la synodalité « utilise déjà une terminologie typiquement sociologique (‘structures’ et ‘processus ecclésiaux’) plutôt que juridique ou canonique (‘institutions’ et ‘procédures’), mais cette dérive semble encore plus marquée si nous lisons le ‘Vademecum pour le synode sur la synodalité’ mis à disposition par le secrétariat général du synode des évêques », où il est question de « leadership collaboratif et plus vertical et clérical mais horizontal et coopératif » formulé par la sous-secrétaire du synode des évêques, sœur Nathalie Becquart.
« À la lumière de ces références – observe Fantappiè – on pourrait supposer que, de manière plus ou moins larvée, derrière le processus synodal, il y ait une tentative de réinterpréter l’office ecclésiastique des évêques, des curés, des autres collaborateurs comme une fonction d’animation pastorale plutôt que d’un ministère sacré auxquels seraient réservés certains rôles institutionnels bien déterminés ».
Une cinquième et dernière équivoque à éviter, écrit Fantappiè, c’est justement « l’identification du concept de synodalité avec la dimension pastorale ». Quand le programme de la nouvelle synodalité s’inscrit « dans la triade communion, participation, mission », on lui confie un rôle démesuré à un point tel que « sa réalisation ne peut que relever de l’utopie ».
À l’énumération de ces cinq risques du soi-disant « remède » de la synodalité, auquel beaucoup attribuent la capacité « de remédier à tous les maux de l’Église », Fantappiè ajoute la suggestion de trois « précautions d’emploi ».
La première, c’est de rétablir pour la synodalité « des limites précises dans le cadre de sa mise en œuvre », pourquoi pas en ouvrant de nouveaux espaces à la « participation de tous les fidèles au ‘munus regendi’, c’est-à-dire au gouvernement de l’Église dans les trois fonctions traditionnellement distinctes que sont le législatif, l’exécutif et le judiciaire », en partant du principe que « tous les pouvoirs de gouvernement ne requièrent pas d’être associées à aux ordres sacrés ; au contraire, certaines d’entre elles seraient plutôt à rattacher, en matière de prérequis de compétence et de témoignage chrétien spécifique, au sacerdoce royal de tous les fidèles », en particulier dans le secteur judiciaire.
La seconde précaution serait de « se soustraire à la confusion entre synodalité et démocratisation ». Et la troisième ? C’est la plus indispensable de toutes : « éviter que la nouvelle synodalité ne modifie les équilibres de la constitution divine de l’Église ». Et Fantappiè d’expliquer :
« Même si elle n’est soutenue que par des minorités au sein de l’Église, il ne faut pas sous-estimer le danger issu d’une vision désacramentalisée de l’Église qui voudrait plus ou moins consciemment se calquer sur une communauté démocratique pleinement inscrite dans le contexte des formes modernes du gouvernement représentatif. C’est pour cette raison que les partisans d’une telle vision de la synodalité ont tendance à contester la structure hiérarchique et cléricale, à réduire le rôle de la doctrine de la foi et du droit divin, à négliger la centralité de l’Eucharistie et à concevoir l’organisation ecclésiale sur le modèle congrégationnel (une Église d’Églises) ».
Bref, écrit Fantappiè en s’adressant aux lecteurs et en particulier aux théologiens et aux canonistes :
« Les espoirs d’une nouvelle perspective qu’ouvrirait le ‘chemin synodal’ dans la vie de l’Église ne doivent ni être gâchés en brûlant les étapes, ni détournés dans leurs intentions, ni édulcorés dans leur mise en œuvre. Ce programme demande plutôt à faire l’objet d’une vérification dans ses préalables doctrinaux et à être pondéré dans son articulation toute entière, de manière à renforcer sa cohérence théologique, sa solidité canonique et son efficacité pastorale. Il en va d’un devoir de critique constructive et non pas destructive d’en identifier les points faibles et d’en proposer les compléments nécessaires, en pleine harmonie – pourrait-on dire – avec ‘l’esprit synodal’ de l’Église ».
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.
