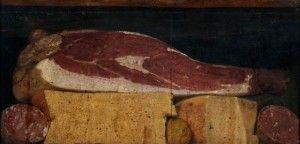Le gras, la mort et le sexe: le Carême aujourd’hui
 Ou comment le bien-être a pris la place de ce qui est bien, la prévention celle de la santé, l’exercice physique celle de l’exercice de la vertu. La diététique celle du jeûne, l’obsession contre les aliments gras celle des privations alimentaires. Tel est le nouveau moralisme néo-gnostique. C’est ainsi que nous sommes passés du regimen salvationis au regimen sanitatis.
Ou comment le bien-être a pris la place de ce qui est bien, la prévention celle de la santé, l’exercice physique celle de l’exercice de la vertu. La diététique celle du jeûne, l’obsession contre les aliments gras celle des privations alimentaires. Tel est le nouveau moralisme néo-gnostique. C’est ainsi que nous sommes passés du regimen salvationis au regimen sanitatis.
Du regimen salvationis au regimen sanitatis
Nous voici en Carême. Peut-on rêver meilleure période pour parler du gras et du maigre, de la nourriture et de l’abstinence, de la vie et de la mort? Le gras, le sexe et la mort. La foi. Que reste-t-il aujourd’hui de l’abstinence chrétienne ? En fait, rien ne se perd au sens religieux des choses qui sont inscrites dans l’homme, tout se transforme. Fini donc l’aspect pénitentiel du Carême, il est aujourd’hui politiquement incorrect et démodé, quand il n’est pas considéré par certains comme une forme de néo-pélagianisme. Nous voici aujourd’hui à l’aube du néo-gnosticisme.
Il est vraiment curieux, pour ne pas dire triste, de voir qu’à l’audience du mercredi à Saint-Pierre, en ce tout début de Carême qui s’ouvre par ce temps fort des Cendres, quelqu’un n’a rien trouvé de mieux à faire que d’offrir des saucissons et des gâteaux au pape. En effet: chassez Pélage et c’est Lucullus qui arrive au galop. Il y a vraiment de quoi se demander si ceux-là sont encore chrétiens. Ou peut-être n’est-ce pas triste du tout s’agit-il en fin de compte d’un devoir salutaire d’offrir des saucissons au pape pendant le Carême. Vous allez comprendre.
La mort obscène
Comment les abeilles meurent-elles ? J’ai posé cette question a un apiculteur qui se trouve également être un blogueur catholique bien connu: : Francesco Colafemmina. Ce qu’il m’a raconté m’a laissé profondément marqué par la délicatesse de ce qui semble être un véritable rituel funéraire, antique, immuable, un office pieux et presque chrétien pourrait-on dire et en tout cas tout imprégné d’une poésie ancestrale.
Les abeilles ne vivent que 50 jours. Je n’imaginais pas que leur vie puisse être si brève. Malgré cela elles ont une mémoire gigantesque, comme si elles devaient vivre centenaires. Je réponds à l’apiculteur que si le deuil c’est faire mémoire, alors les abeilles sont toujours en deuil: leurs jours sont tellement courts. Mais le temps est relatif, c’est une superstition, il n’existe pas. La mémoire ne compte pas les heures et Dieu non plus car n’est-il pas écrit: « pour Lui, un instant dure toujours et l’éternité n’est qu’un instant » ?
Les abeilles ouvrières vivent de février à août, 50 jours pour les plus frêles, 60 pour les plus robustes. Il est écrit: « Le nombre de nos années ? Soixante-dix, quatre-vingts pour les plus vigoureux ». Toutefois, les abeilles nées fin août vivent jusqu’à 180 jours. La reine, quant à elle, peut vivre 5 ans.
Mais quand une abeille meurt, que devient son petit corps? J’ai posé la question à mon ami.
Le matin, les abeilles ramassent les cadavres, les transportent à tire d’ailes à distance de la ruche et elles les déposent de préférence sur un brin d’herbe. « C’est une cérémonie à laquelle j’ai moi-même assisté à de nombreuses reprises » elles se sont endormies avec cette pensée et elles se sont rapidement réveillées avec la même pensée. Dans une ruche nous ne trouverez nulle trace de cadavre ni même la plus petite trace de saleté. Cette scène m’a complètement retourné, presque jusqu’aux larmes: l’abeille défunte reposant sur un brin d’herbe, laissée au souffle du vent et à la douce caresse de la brise de l’aurore, avant que le soleil ne se lève.
Représentons-nous cette scène, l’été à six heures du matin, aux premiers feux du jour qui se lève. Les abeilles ramassent leurs petites soeurs, choisissent soigneusement un brin d’herbe, y déposent leur fardeau et d’un battement d’ailes, le laissent retourner à la terre. C’est émouvant. Sans aucun doute.
C’est ainsi que meurent les abeilles. Mais comment l’homme meurt-il, lui? Qui le transporte hors de son « alvéole humaine », loin de sa ville, de son immeuble pour le faire reposer avec autant de poésie? Qui a pitié de lui? Qui sont ses « frères » qui, à l’instar des abeilles, les déposeront sur un brin d’herbe ou une fleur de mai ou sur la terre meuble?
Je le découvre, pour la énnième fois, dans les pages du Messagero que je feuillette un dimanche matin, attablé au bar l’Africano.
« Pauvre papa, il n’a jamais eu de chance quand il était en vie, il n’en a pas eu davantage après sa mort. Je l’ai vu mourir deux fois: je le regardais et j’avais honte », déclare sa fille Debora. Maurizio Sebastianelli, 52 ans, 180 cm pour 130 kilos meurt subitement avant Noël. C’est sa fille doit s’occuper seule des funérailles: elle se rend à l’Ama, l’agence communale de Rome qui s’occupe des funérailles des indigents et on lui demande 2.300 EUR qu’elle doit emprunter. Elle ne demande qu’une seule faveur: un cercueil qui soit assez grand et résistant, « renforcé » pour son corpulent papa qui est mort. Mais dans la métropole, dans les méandres de la bureaucratie communale, dans tout ce fatras « public », personne ne voit et personne n’entend, personne ne connaît personne et ne prête attention à ce signal instinctif qui caractérise notre humanité commune: l’empathie. Il n’y a que des numéros, que l’apathie administrative ordinaire et si en outre on est pauvre, alors on n’est plus rien. Juste un poids pénible à expédier sans trop de sentiment et surtout sans trop perturber l’indolence de qui que ce soit.
En lisant tout cela, je me surprends à penser à comment meurent les abeilles. A comment il serait merveilleux d’être une abeille, entourée d’autres abeilles pour le dernier voyage: s’envoler une dernière fois à l’aube, portée par les ailes de mes soeurs qui me déposeraient sur un brin d’herbe caressé par la brise matinale, être emporté par les premiers souffles du vent du premier jour puis basculer délicatement dans la terre meuble.
Ils débarquent à la maison de Maurizio avec un cercueil quelconque, ni renforcé ni même assez grand. C’est tout ce que la commune de Rome est disposée à fournir: comment serait-il d’ailleurs possible, étant donné le caractère politiquement incorrect du « gras » que l’Ama ne soit pas elle aussi en guerre contre l’obésité? Pas de cercueil pour les gros! Les personnes obèses ne sont pas prévues à Rome parce qu’en plus de faire tache dans le décor et de blesser l’esthétique, elles constituent une offense à la santé publique, sans compter qu’elles sont surtout pénibles à transporter quand elles sont mortes. Elles ne sont pas dignes d’avoir un cercueil correspondant à leur tonnage honteux et malsain, indubitablement à la source de cette mort prématurée qu’ils ont tout de même un peu cherchée. Et en plus ils se plaignent? Ma commune a des cercueils pour les nains, les difformes, les pygmées et même les géants mais pas pour les obèses. Pas question de discuter. L’obésité est une maladie socialement honteuse.
Ils compriment donc, obscènes, le cadavre de Maurice dans le cercueil. Ils hissent le cercueil et le soulèvent. Le cercueil cède sous le poids. Le cadavre passe outre dans un craquement lugubre. La fille s’enfuit horrifiée et sort dans la rue en hurlant. Elle est embarquée aux urgences en état de choc. Peu importe: on glisse une feuille de zinc sous la dépouille, on enveloppe le cercueil brisé dans une couverture et on se rend à l’église malgré l’énorme retard. J’imagine la pénible suite de cette histoire: ils arrivent encore plus en retard aux cimetière de la Prima Porta avec le cadavre pantelant et il est trop tard pour l’enterrer: les défunts obèses de Rome n’ont même plus ce droit à ça. Quelqu’un s’en serait bien préoccupé le lendemain, pour autant qu’on ait trouvé une niche d’une capacité suffisante et, pour ce qui est de l’enterrement en pleine terre, il n’y a pas si longtemps quelqu’un prétendait que « les gros polluent plus que les autres » la terre et les nappes aquifères, même s’il n’y en a pas sous le cimetière, c’est pareil… Les brûler? Ils polluent beaucoup trop l’air et consomment trop d’énergie. C’est simple: ils ne devraient pas exister ou bien ils n’ont qu’à maigrir.
Malheur aux gros. Et malheur surtout aux solitaires et aux pauvres: il n’y a pas de plus grande tristesse que de recourir à la ville pour des funérailles d’indigents dans l’anonymat des métropoles. Déjà qu’ils sont pauvres, ils n’ont pas à être gros. Un pauvre ça devrait être efflanqué: pas question de cercueils grande capacité ou haute résistance. Quatre feuilles de contreplaqué suffisent. Mourir en ville ce n’est pas seulement triste, ça devient même dangereux.
J’ai parfois été tenté de fonder un ordre religieux qui ne s’occuperait que des morts (une autre périphérie existentielle) et de pompes funèbres. Ne juge-t-on pas le niveau de civilisation et d’humanité d’un peuple à la façon dont il traite ses morts? La mort sans le sacré qui seul peut préserver la pudeur qui revient aux morts, ce serait la fin de l’humanité.
Le gras amer
C’est ainsi que l’homme meurt, tel est son dernier voyage d’infortune. Et alors, je me remets à penser à ces abeilles si légères. Mais je pense aussi que le gras est plus amer que la mort. Il n’en a pas toujours été ainsi: autrefois symbole de beauté, marque de santé, preuve d’opulence, expression de la paix morale et sociale, le gras était une bénédiction divine. On se privait de gras en carême précisément à cause de son caractère festif, parce qu’il s’agissait d’un délice à table et un d’un raffinement sur le corps. Il n’était pas de bon ton de l’exposer dans ce temps fort et pénitentiel parce que la pénitence consiste justement à se priver de quelque chose d’agréable, sinon l’on aurait cessé d’être triste et contrit. Le gras avait la saveur et la consistance d’une vie bénie par la surabondance de la grâce. C’était la joie de vivre.
Dans l’un de ses nombreux actes d’autodestruction, une certaine génération post-conciliaire a libéralisé les préceptes et les pénitences, les abstinences et les jeûnes dans les temps forts pour les laisser à la libre initiative et à la fantaisie des fidèles. Avec la conséquence qu’ils finirent par tomber en désuétude et que la foi elle-même, qui consiste aussi à faire ou à ne pas faire certaines choses en des temps déterminés, finit par s’en ressentir. Peu à peu, cette libéralisation des préceptes a cédé la place à une diabolisation et à une répression de l’acte pénitentiel. Dans cette furie dévastatrice, même le péché a été lui-même « libéralisé » et quasiment, « aboli » ainsi que le repentir et la réparation.
Mais ce qui est supprimé en haut est destiné à réapparaître en bas sous une autre forme. Et dans notre cas, aujourd’hui, l’affadissement du sens du péché (et de la réparation pénitentielle) réapparaît sous l’avatar de la culpabilité alimentaire et esthétique. Les abstinences d’autrefois — par exemple manger maigre le vendredi — qui avaient une valeur religieuse et purificatrice liés au regimen salvationis ont cédé la place à la diabolisation des aliments gras et donc “impurs” où la graisse est devenue synonyme de maladie et de vice, de mort potentielle, synonymes qui se sont substitués aux concepts de péché, de vice et de damnation. La culpabilité individuelle d’autrefois s’est muée, toujours à cause de l’abus de graisses, en une culpabilité et en une stigmatisation sociale. La négligence de la réparation et de la purification qui trouvaient leur source dans la peur du péché a fait place à la phobie de la souffrance et à l’obsession esthétique. Le corps a envahi la place occupée par l’âme alors qu’il n’était autrefois que l’autre moitié de l’homme.
La chair immonde
Je suis bien entendu un disciple de Piero Camporesi et il suffit de le lire pour comprendre bien des choses. L’ancien testament mobilise ad nauseam de façon névrotique toute la religiosité juive sur les interdits alimentaires: l’interdit le plus pesant est celui de la viande, le plus raffiné et essentiel de tous les délices, la source originelle de toute « corruption » à partir du moment où l’on considère la bouche comme la porte d’entrée royale de tous les vices.
Ensuite, le christianisme est arrivé et a fait voler en éclats ce terrorisme alimentaire pour laisser au chrétien, à l’exemple de Jésus qui était lui-même un grand mangeur, une liberté alimentaire totale sur tous les aliments. Mais en fin de compte, même le christianisme semble récupérer les abstentions alimentaires de jadis: il n’est plus question d’aliments purs et impurs mais de pénitence, de privation temporaire en fonction des temps liturgiques et il s’agit donc davantage d’une forme de sacralisation du temps à travers certains aliments. En réalité surtout de l’aliment par excellence, la plus prestigieux d’entre tous: la viande. Non pas parce qu’elle serait impure mais bien à cause de son caractère “impénitent”, un luxe duquel il convient de se priver pendant les temps forts: il n’est pas ici question d’éviter d’être contaminé par l’impur mais bien de purification, le problème concerne la personne elle-même et non pas l’objet de ses appétits.
En fin de compte, comme je l’ai déjà dit, le Concile a fait place nette de tout cela en bousculant les habitudes sacrées de catholiques, avec la conséquence dommageable de désacraliser le temps en s’en remettant aux « propres possibilités de chacun » dans lesquelles l’objectif communautaire est dissous dans les égoïsmes individuels. La dimension pénitentielle disparaît en même temps qu’une manifestation tangible du temps sacré chez les catholiques.
On pourrait dire que ce que les autorités religieuses rejettent avec force, ce que la sécularisation de masse voudrait à tout prix chasser par la porte rentrerait ensuite par la fenêtre sous une autre forme. Qu’est-ce que cette terreur sans cesse grandissante sur la consommation de viande sinon une réminiscence déformée des anciens interdits hébraïques et des abstinences chrétiennes? Qu’est-ce que ce retour laïc si politiquement correct à l’abstinence viande et quelle est ce présage apocalyptique autour de son impureté qui se manifesterait sous forme de cancers, infarctus et autres excès de graisses en cas de consommation régulière? Qu’est-ce donc sinon un retour au sacré d’autrefois, défiguré, profané, presque dépouillé de toute référence au divin et à tout message eschatologique?
Je dis “presque” parce qu’aujourd’hui, ces mêmes militants végans ou végétariens se réfèrent de plus en plus souvent à des textes sacrés plutôt imaginaires et plus ou moins manipulés qui sont le fruit d’une exégèse téméraire, naïve et idéologique pour soutenir leurs thèses et leurs théorèmes néo-puritains, leur éthique des nouvelles abstinences, « naturelles » selon eux, pendant qu’ils démontrent, la bible dans une main et la vie des saints — catholiques — dans l’autre, qu’il n’est pas “naturel” d’être carnivore. Il s’agit donc d’une tentative de resacraliser dans un environnement purement laïc une tendance déjà sacrée mais qui était tombée en désuétude dans un contexte religieux et qui, là où elle subsiste de façon résiduelle, comme dans certains milieux juifs, se voit taxée de pharisaïsme et accusée de reporter sur des pratiques désormais dénuées de sens — ou dont on a oublié le sens profond — la valeur que devraient avoir les faits seuls et les catégories de l’esprit plutôt que les recettes de cuisines.
Le chaste sexe
Si la bouche est la porte d’entrée de tous les vices, les parties génitales, et donc le sexe, en sont le reflet conditionné et le cloaque: la continence à table a toujours été considérée comme le chemin vers la continence au lit. Ce n’est pas un mystère que jadis, en période de carême, même l’abstinence sexuelle au sein du lit conjugal était considérée comme louable en tant que compagne du jeûne: la purification du corps, temple de l’esprit, devait être totale, « d’un orifice à l’autre » expliquait le poète.
Qu’en est-il aujourd’hui dans notre époque laïcisante et néo-puritaine… en un mot néo-gnostique? Le sexe était l’apex de tous les vices, le zénith et le nadir du péché le plus commun et le plus humain et donc également le plus contagieux et le plus impur: l’unique remède était l’abstinence ou “plutôt que de brûler”, de se marier, comme disait Saint Paul. Si le sexe portait en lui le germe du péché et de la dissolution tant que nous étions chrétiens, aujourd’hui que nous ne pouvons plus nous dire chrétiens, la peur du “virus” a pris la place de la peur du péché: le sexe « transmet des maladies » de sorte qu’aujourd’hui comme hier, il reste « sale » et « infect » et donc potentiellement vecteur de mort. Sur le plan symbolique et concret, la terreur de la contamination virale a remplacé l’horreur de l’impureté morale. Si l’on se défendait autrefois de l’impureté par la chasteté, aujourd’hui il n’existe contre la contamination virale qu’une seule défense apparemment concrète et bien plus symbolique qu’il n’y paraît: le condom. Une chasteté sublimée.
Comme l’affirme notamment l’anthropologue Piero Camporesi, le préservatif, malgré sa sécurité relative, a remplacé la culpabilité chrétienne. La « sécurité » du rapport devient l’anti-péché, l’acte pénitentiel et l’absolution préventive. Le sexe est rendu « chaste » par cette membrane isolante qui préserve du contact direct avec l’impureté. Puisque le vrai péché du notre temps c’est la maladie, la transmission du virus comme autrefois on “transmettait” le péché par des actes de corruption qui se voyaient également sur le corps et le décomposaient. La maladie physique pouvait en effet être à une certaine époque considérée comme une conséquence physiologique de la maladie morale.
Le condom est le remède à la renonciation au sexe, l’unique système d’immunisation de la concupiscence et du virus dévastateur qui lui est associé, un peu comme le mariage était autrefois le remède aux feux de l’enfer. Le condom rend le sexe stérile, il en neutralise symboliquement le germe de vie qui porte en lui celui de la mort, qui était auparavant rendu inerte par l’abstinence sexuelle. De la sorte, il assume tous les attributs de la chasteté et de l’ascèse, de l’élévation et de la vertu scrupuleuse qui préserve et absout celui qui la pratique et celui qui la reçoit. Le préservatif a substitué au plan symbolique et inconscient la santé du corps à celle santé de l’âme, sanctifiant la première en sacrifiant la seconde.
Du bien au bien-être
Le bien-être a pris la place de ce qui était bien La prévention celle de la sainteté. L’entraînement physique celle de l’exercice de la vertu, la diététique celle du jeûne, l’obsession contre les graisses celle des abstinences alimentaires. La viande sacrée, délice entre tous, symbole de la perpétuation de la vie de laquelle l’on s’abstenait par pénitence comme l’on s’abstient d’un plaisir a fait place au végétarisme à la mode qui s’est mué en une forme de répulsion: la viande devient la manifestation du cadavre et de la putréfaction qu’il faut fuir comme l’on fuit de l’idée même de la mort que l’on se refuse à accepter.
C’est le refus de l’impermanence inévitable, imprimée dans la chair de l’homme du péché originel dont le souvenir a été effacé et dont l’effacement se trouve à la source de tous les déséquilibres. Après tout, l’impermanence, la souffrance, la vieillesse et la mort ne nous apparaissent-elles pas incompréhensibles et inacceptables? On divinise le corps et on le déshumanise en l’embaumant pour le conserver, on l’oint de baumes miracles, on lui injecte des élixirs de jeunesse éternelle justement pour masquer et exorciser les affres de cette mort latente exhalée chaque jour un peu plus par tous ses pores qui sentent venir la décrépitude. C’est ainsi que le rituel du régime de printemps pour pouvoir « entrer à nouveau dans son maillot » pendant les mois d’été a pris la place de la nourriture maigre du carême en attente de Pâques.
Il s’agit d’un retour à une forme de néo-gnosticisme qui aurait la même rigueur moraliste et la même intransigeance que le puritanisme calviniste. Mais en parallèle à cet hédonisme de masse nous assistons logiquement et paradoxalement à une guerre schizophrénique incessante et moraliste contre le plaisir: la nourriture, les graisses, le tabac et l’alcool. Seul le sexe apparaît comme licite et même fortement conseillé pour autant qu’il soit « protégé » et stérile, sans contact. Cette version a pris la place du sexe “conjugal et fécond” du christianisme. Sur tout cela plane le spectre de la mort, précisément au moment où l’on se refuse à l’idée même de la mort.
Il ne s’agit de rien moins qu’un renversement symbolique et concret de la morale chrétienne. Une nouvelle morale privée de signes et de sens, privée de l’aspect intemporel et rempli de prétentions mondaines qui nous est à nouveau infligée, désacralisée et sécularisée, renversée et vidée de sa substance avec une agressivité, une intolérance et un fanatisme inconnu des générations chrétiennes. Un tel acharnement n’était coutumier que des populations puritaines et calvinistes d’autrefois justement parce qu’elles étaient privées de cette soupape de sécurité qu’était sacrement de la pénitence. Car ne c’était pas par amour de Dieu qu’elles pratiquaient et s’astreignaient à de telles règles inflexibles mais bien par peur de Dieu et par peur de l’opinion des autres. Cette vox populi plus moralisante que les moralistes prend peu a peu la place du justement de Dieu et ne connaît plus que deux types de personnes: les purs et les impurs. Cela alors que le catholicisme, lui, ne reconnaissait qu’une seule catégorie: les pêcheurs. Les impurs d’aujourd’hui, les parias du règne sont avant tous les gros, véritables damnés de cette éden obsessionnel et gnostique. La graisse nous apparaît comme l’onguent de la mort alors qu’il y a à peine quelques années, c’était la maigreur qui préfigurait la mort: cette « faucheuse » n’était-elle pas toujours représentée comme un spectre squelettique, privée de graisse et de chair à part quelques lambeaux grisâtres et desséchés? La vie s’en était allée en emportant le précieux trésor de graisse qui lui donnait forme et apparence humaine.
Comment à présent conclure cette longue réflexion centrée sur la graisse et le carême? J’ai presque envie de dire qu’aujourd’hui, la véritable pénitence à respecter en cette période de carême serait non pas l’abstinence du gras mais l’abstinence du maigre. L’unique purification possible dans ce monde néo-gnostique de masse obsédé par le corps et la maigreur, c’est d’engraisser en carême non pas par plaisir égoïste mais pour l’amour de Dieu.
Par Antonio Margheriti, d’après un article original en italien traduit et publié avec l’autorisation de l’auteur.